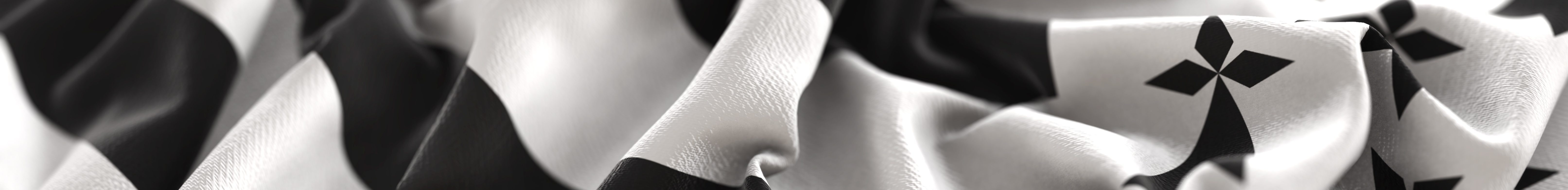Jean-François Davy est un réalisateur iconoclaste, sorte de trublion du grand écran à qui l’on doit des succès atypiques, dont Exhibition en 1975, et ses trois millions d’entrées après une sélection au festival de Cannes. Bretagne Actuelle l’a rencontré une semaine après la sortie de son nouveau film, Vive la crise, dans lequel il projette la France au cœur d’une société rétro-futuriste où les plus faibles aspirent avec joliesse et emphase à vivre comme les plus forts.
Jérôme Enez-Vriad : Pourquoi n’êtes-vous pas allé à Cannes cette année ?
Jean-François Davy : Parce que je n’ai plus rien à y faire. J’ai besoin de prendre du recul après l’échec de mon dernier film.
Vive la Crise, avec Jean-Claude Dreyfus et Jean-Marie Bigard…
J-FD : Mais aussi Florence Thomassin, Michel Aumont, Rufus, Dominique Pinon et bien d’autres acteurs fort talentueux qui, avec l’équipe technique, ont mis leur cachet et leur salaire en participation. Tous ces gens m’ont fait confiance malgré l’échec du film. Je souhaite impérativement leur rendre hommage par ces quelques mots.
Comment expliquez-vous cet échec ?
J-FD : Je n’ai aucune explication tangible. Si j’avais raté mon film, je comprendrais, mais c’est mon meilleur, tout le monde le dit. Vous savez, je suis un cinéaste marginal, indépendant, grande-gueule, pire que Mocky ! (Tiens ! mettez-le en titre), parce que je souffre d’une non-reconnaissance malgré de beaux succès populaires. J’ai tout fait pour concrétiser un excellent film mais le public le rejette comme l’avait rejeté la profession en amont puisqu’aucun producteur ne m’a fait confiance. J’ai vendu mon appartement pour financer le projet, mis un million de ma poche, employé les meilleurs professionnels, aucune erreur marketing n’a été commise, tout est nickel, chiadé, impeccable, et rien. Un film c’est une proposition. Le public la prend ou la rejette.
Certes, mais un film a plusieurs vies, à court, moyen et long terme.
J-FD : L’amortissement financier se joue à court terme, c’est-à-dire le temps de son exploitation en salles. Pas d’entrée ou insuffisamment et les distributeurs le retire de l’affiche. Mais vous avez raison, il existe ensuite un second crédit qui, bien souvent, s’engage à long, voire très long terme. Louis Malle me confiait un jour que les plus grands films ont été des échecs à leur sortie. Prenez Citizen Kane, non seulement il s’agit du chef-d’œuvre d’Orson Welles, mais aussi et surtout d’un des plus grands films de l’histoire du cinéma, et bien soixante-dix ans après il n’est toujours pas amorti parce que ce fut un échec commercial lors de sa sortie.
L’argent est donc le nerf de la guerre ?
J-FD : Personne ne travaille gratuitement et tout travail mérite salaire. Cela dit, pour qu’un film « marche » il doit avant tout être connecté avec l’époque. Je pense que les gens en ont marre de la politique. Le bien-vivre ensemble séduit à condition de ne bousculer personne. Les marginaux rejetés, hors système, même s’ils ont de l’humour et de l’emphase, dérangent parce qu’ils renvoient à notre propre égoïsme. Les problèmes sociaux saturent tout le monde par crainte d’avoir à s’y confronter un jour. J’ai pourtant mis tout ce que j’aime dans ce film. Mes convictions, mes doutes, mon cœur, mes tripes et mon âme. Un travail énorme accompli pour le plaisir de partager une philosophie dont manifestement pas grand monde ne veut.
Quelle est cette philosophie ?
J-FD : Notre espace c’est le monde. L’union. Jouissons et arrêtons de nous enfermer. Participons entre nous et avec les autres. Grandissons ensemble. Ouvrons-nous comme Montaigne et La Boétie, personnages phare de mon film, respectivement interprétés par Jean-Claude Dreyfus et Jean-Marie Bigard. L’enfermement est délétère. C’est parce que les gens se replis sur eux-mêmes qu’ils arrivent à commettre des attentats pour se prouver qu’ils existent. Il faut s’ouvrir au monde et à la réalité.
Mais le cinéma n’est-il pas au contraire fait pour sortir de la réalité ?
J-FD : Au cinéma tout est désir et illusion. On se fait une toile pour un ailleurs de 90 minutes. Dès que vous entrez dans une salle, vous n’êtes plus dans la réalité. Même si l’histoire transcende les évidences, elle engage une autre vérité. De guerre ou d’amour, les films sont du rêve pelliculé, et les gens qui aiment le cinéma fuient en général leur quotidien, parfois même leur vie. Voyez-vous, au cinéma il existe deux voies royales : réalisateur et spectateur. Le réalisateur c’est Dieu. Les spectateurs sont les disciples d’une religion sur grand écran. Mais sans disciples, les religions s’effondrent et Dieu avec.
Votre père était peintre. Vous a-t-il transmis le goût de l’image ?
J-FD : Merci de l’évoquer. Mon père s’appelait Bernard Davy. Peut-être sa peinture n’est-elle pas pour rien dans mon parcours. Je n’y ai jamais réfléchi. En revanche, je n’arrive plus à me défaire de ses toiles. Cela m’est impossible. Un peintre c’est comme un réalisateur, quand le public ne veut plus de lui il continue d’œuvrer, seulement ses toiles s’entassent contre un mur. Je reste réalisateur dans l’âme.
Qu’allez-vous faire maintenant ?
J-FD : Ecrire. Ce que je souhaitais mettre en images, je vais en faire un livre. Production : une ramette de papier et des crayons. Bertrand Blier avait fait un livre des Valseuses avant de tourner le film. Idem avec Balasko et Cliente. Alors peut-être ferais-je aussi un film de ce livre autobiographique.
Vous n’arrêtez donc pas le cinéma ?
J-FD : Pas si le désir vient des autres. Pas si l’on vient me chercher. Pialat l’a dit à Cannes : « Si vous ne m’aimez pas, je ne vous aime pas non-plus. » Je reprendrais son propos à l’inverse. Si vous voulez que je vous aime, aimez-moi. Si vous voulez de moi, faite-le moi savoir.
Des regrets ?
J-FD : Aucun. J’ai eu une carrière formidable. Exhibition a fait 3 millions d’entrées. J’ai dirigé les plus grandes actrices de la Nouvelle Vague, Bernadette Lafont, Anna Karina… J’ai une femme merveilleuse, qui m’aime et que j’aime. Mon dernier film est une réussite même si le public ne va pas le voir. Et j’ai un projet de livre dont, peut-être, ferai-je un film. Rien n’est moins sûr. Peu importe. Je suis en vie et en bonne santé.
Quel en sera le titre ?
J-FD : Du film, aucune idée. Du livre : Un grand moment d’éternité.
Si vous aviez le dernier mot, Jean-François Davy ?
J-FDavy : VIVRE. Il faut l’écrire en majuscule et le dire en ronronnant fort, comme le faisait Galabru.
Interview réalisée le 18 mai 2017 à Paris.
© Jérôme Enez-Vriad & Bretagne Actuelle
Vive la Crise
Un film de Jean-François Davy.
Avec Jean Claude Dreyfus, Jean-Marie Bigard, Michel Aumont, Dominique Pinon, Rufus, Henri Guybet, Philippe Caroit…