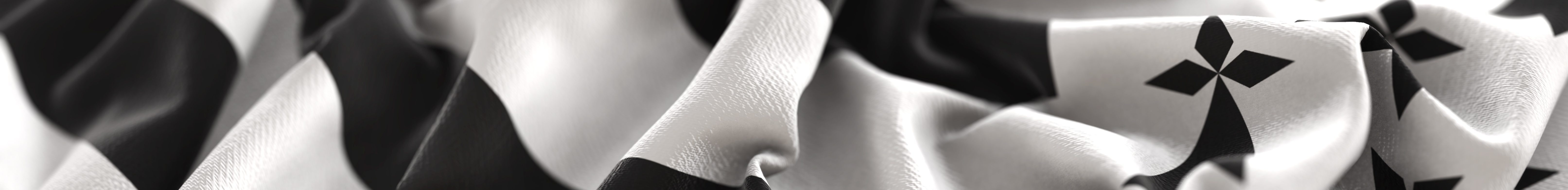Fils de Préfet du Morbihan, Bertrand Burgalat aurait pu mal tourner et faire de la politique. Pire : il fait de la musique et sort cette année son neuvième album « Les choses qu’on ne peut dire à personne ». Producteur et patron du label Tricatel, l’homme sait donc sortir de sa bulle et nous parle de son disque – évidemment – mais aussi de décentralisation, de Houellebecq ou encore de la crise du disque. Rencontre.
Votre album est sorti au lendemain du second tour des élections présidentielles françaises. Quel regard porte le citoyen Burgalat sur la politique ?
J’ai un regard presque technique comme quelqu’un qui s’intéresserait au football sans soutenir une équipe. Mais ce n’est pas un regard distant. Ça m’intéresse, parfois ça m’attriste. En tant qu’artiste je considère que ma voix n’a pas plus de poids que celle d’un d’autre. Et le fait de m’occuper aussi d’un label – qui est une communauté avec les artistes mais aussi les gens qui travaillent pour celui-ci et qui ont tous des opinions extrêmement diverses –cela m’interdit certaines prises de paroles.
En revanche, je m’exprime très facilement sur des sujets sociétaux, par exemple sur l’aménagement du territoire, car cela m’intéresse beaucoup. Je suis du Sud-Ouest, mais j’ai habité à Vannes quand j’avais entre 3 et 6 ans, mon père était préfet du Morbihan. Je me souviens, quand on prenait le train à Montparnasse pour Vannes, c’était la journée ! Aujourd’hui, c’est 2h30. Alors que dans le Sud-Ouest, c’est complètement l’inverse. Quand Macron était au ministère de l’Economie, une des seules mesures concrètes que je l’ai vu prendre, c’était le rétablissement de la troisième classe avec les autocars. Je trouve que c’est d’un mépris social terrible. J’espère qu’il va faire autre chose ! Nous embêter avec la transition énergétique et mettre en place les « autocars Macron », c’est terrifiant ! (rires).
Il y a un conflit entre l’artiste Burgalat et le chef d’entreprise Burgalat ?
Non. Je suis le chef d’une TPE très artisanale. Je trouve, que produire de la musique permet de ne pas se prélasser dans un pseudo confort d’artiste, où on est censé être dans son monde. Cela me permet d’être connecté à la réalité, de me poser des questions. Ainsi, je me suis toujours battu contre l’exception culturelle. Ce que l’on interdisait aux plombiers, on allait l’autoriser au cinéma ! La musique, la culture en générale, ce n’est pas du tout une exception. C’est un baromètre. La musique a été la première industrie vraiment impactée par le numérique. On a dû affronter seuls toutes ces questions, sous les leçons des journaux qui, 3 ans après, ont été confrontés à la même chose, et qui ont dégraissé et fait du plan social sans état d’âme. Nous, on a au moins essayé d’affronter cela. La question qui nous était posée c’était : comment faire pour continuer à produire et à fabriquer tout en gagnant notre vie et en payant tout le monde ? Aujourd’hui, c’est l’ensemble de l’économie qui est confronté à ça.
« Je continue à me battre pour que la musique ne devienne pas subventionnée »
La musique a-t-elle son business modèle ?
Elle va un peu mieux. Le streaming augmente un peu. C’est la première fois que certaines courbes s’inversent. On revient de loin quand même. Le streaming commence à rapporter quelque chose maintenant. Le seul problème, c’est que c’est au prorata des écoutes et non pas des comptes. Les petites et les grosses structures sont à peu près dans le même bateau, sauf là-dessus. Les majors et les gros indépendants ont des logiques de catalogues. Je pense que les majors commencent à s’en mordre les doigts car le système est aussi utilisé dans les musiques urbaines. Il y a des mecs qui sont plus malins qu’eux, qui font les trucs en direct en se passant d’eux et qui réussissent à obtenir un nombre d’écoutes – on ne sait pas comment – très grand. Au bout d’un moment, on sera obligé d’adapter les règles.
Enfin, l’industrie musicale en a bavé, comme d’autres industries. On n’a pas une solution miracle. Je me suis beaucoup battu et je continue à me battre pour que la musique ne devienne pas subventionnée, c’est-à-dire avec des gens qui seront bons pour accrocher tel ou tel décideur et non pas leur public. C’est encore plus vrai en province d’ailleurs. Parce qu’aujourd’hui, je pense qu’un label a souvent une opposition province / Paris qui me paraît complètement hors de propos. Etant moi-même provincial vivant à Paris, je ne suis pas du tout dans cette « gue-guerre » Paris / province. Vivre à Paris et faire de la musique, ça peut avoir des avantages mais aussi beaucoup d’inconvénients : le coût de la vie n’est pas le même, répéter est plus compliqué, etc. Quand on est en province, on a accès à des aides et financements des conseils régionaux et autres, qui n’ont rien à voir avec ceux de Paris. Le fait d’être à Paris et de croiser des gens, ça aussi c’est un mythe.
La province azurait donc du bon. A ce titre vous dite : « La décentralisation doit être accompagnée de contre pouvoirs forts. » Cela veut-il dire que vous êtes pour cette décentralisation ? Ou est-ce votre passé qui vous rattrape ?
C’est mon passé de fils de préfet qui me rattrape. Mon père était d’un village des Pyrénées d’origine modeste. Il a fait la guerre avec Delattre. Il avait ce côté « serviteur de l’État ». J’ai passé mon enfance dans ces palais de la République mais je me rendais bien compte qu’on n’était pas chez nous. Je rentrais au village, ce n’était pas la même vie. Je pense que les préfets à l’époque étaient très décriés, et faisaient du centralisme. Il y avait un contre pouvoir, qui était celui des élus – de droite ou de gauche – dans les années 60-70, avant la décentralisation. Il y avait toujours le pouvoir local avec un personnage puissant. À Vannes c’était Marcelin par exemple. Ce n’était jamais facile entre le préfet et les élus, et je trouve que cela était assez sain. Au bout de 2 ou 4 ans, le préfet changeait de région. Mais un préfet qui aurait eu des amitiés un petit peu douteuses ou qui aurait été trop proche d’un groupe de travaux publics par exemple… Et bien les élus étaient là pour le faire sanctionner. Quand il y a eu la décentralisation qui partait d’excellentes intentions, il n’y a plus eu ce rôle de contre pouvoir car les préfets ne l’ont pas exercé. La chambre régionale des comptes ne l’exerce que dans les cas les plus criants à posteriori.
Vers 1988, après la mort de mon père, je me suis retrouvé tout à fait par hasard dans un conseil régional à écrire les discours du maire. J’ai été sidéré par la médiocrité disons personnelle, par les petits arrangements de corruption, et qu’il n’y ait pas ce contre pouvoir. Les gens se sont faits élire, ils ont des sentiments de « tous puissants ». Ce qui fait qu’ils sont souvent rattrapés, mais des années plus tard. C’est comme les gens qui font de la chirurgie esthétique : ils pensent que cela ne va pas se voir, on leur dit qu’ils ont bonne mine, mais à la fin, on observe la femme panthère. On est dans un monde où tout le monde condamne les turpitudes de l’autre, tout en s’adonnant aux mêmes choses, mais tout le monde finit par se faire avoir. On peut le voir avec François Fillon qui n’a pas été très classe avec son histoire du Général De Gaulle. Le pauvre s’est pris le boomerang puissance 10. Donc ce monde à la fois de vertus et d’imprécations, de transparence, et bien faites attention… Car en 93 avec la terreur, tous les guillotineurs ont fini guillotinés ! C’est ça que je voulais dire… Je trouve qu’il faut faire attention à la décentralisation.
« On ne peut pas tout mettre sur le dos du manque de décentralisation »
Comment expliquez-vous que la décentralisation fonctionne presque partout dans le monde sauf pour la France ?
Parce qu’on a peut-être la culture jacobine. Est-ce que pour le moment on n’a pas le pire des deux mondes ? Le pire du centralisme et une décentralisation sauvage. En travaillant au sein d’une collectivité territoriale, je me suis rendu compte qu’il y avait énormément d’argent, dépensé avec des budgets clefs. À Paris, il y a des appels d’offre déments. Par exemple, on vient carrément d’en donner un à Bernard Arnaud. C’est de l’abus de pouvoir. Je n’aime pas le discours de tout mettre sur le dos de l’Europe, je trouve cela facile. Je trouve que beaucoup de choses qui ne vont pas en France tiennent à notre façon d’agir. On ne peut pas tout mettre sur le dos du manque de décentralisation. Pour ce que je connais en Midi-Pyrénées – ce que j’appellerais la Gascogne – les villes moyennes ont été détruites. Il y a Bordeaux, Toulouse, Pau encore un peu, et puis des villes fantômes. Il n’y a même plus l’excuse de la reconstruction. D’ailleurs, j’en parle dans mon disque dans « Diagonale du vide ». C’est présenté d’une façon un peu fantomatique, mais les paroles évoque cette France dont on ne parle pas forcément, entre Bourges et Cahors, qui semble abandonnée, avec cette voix ferrée qui descend jusqu’à Toulouse…
C’est une chanson dont vous avez écrit les paroles ?
Non, c’est Matthias Debureaux, un ami. On en a beaucoup parlé ensemble parce que c’est un thème qu’on partage.
Pour « Les choses qu’on ne peut dire à personne », les paroles sont signées Laurent Chalumeau. C’est un vieux copain ?
Je le connais depuis longtemps, Chalumeau. Je l’ai connu par un ami. J’adore ce mec ! Je trouve que ses polars sont excellents. Il réussit à parler du monde d’aujourd’hui. Je trouve que c’est brillant et très bien écrit. Sa manière d’écrire sur la musique, en particulier sur le rock français est formidable.
Côté musique, comment définiriez-vous votre style ? Il existe un son « Burgalat », voire un son « Tricatel » ?
Oui mais ce n’est pas prémédité ! En général, c’est fait de façon très organique. La technique, le numérique, intervient en deuxième étape. J’aime utiliser des sons naturels et parfois les rendre un peu plus abstraits. C’est quand même très instinctif en studio. Il peut y avoir des morceaux sur un accord. Il y en a dans le disque : deux morceaux très hypnotiques. Mais autrement il y a des canevas harmoniques où j’aime bien qu’on soit un peu surpris mais que ça ne s’entende pas. En studio, c’est important que ça soit fluide, c’est-à-dire qu’il y ait une joie de faire de la musique qu’on puisse retrouver. On retrouve ça chez Chassol et chez la plupart des artistes du label. Quand je travaille en studio avec d’autres personnes, je ne me dis pas « tiens, je vais appliquer tel son ». Au contraire, avec les artistes du label, je ne suis pas du tout interactionniste. Si on me demande un coup de main sur quelque chose, je le fais volontiers, une partie de basse par exemple. Mais je considère que mon rôle, de label ou de producteur, c’est d’essayer d’amener les artistes le plus loin possible dans ce qu’ils veulent faire, dans leurs idées. Et pas du tout de faire mon propre disque par procuration !
Vous composez d’abord la musique et ensuite les paroles arrivent ?
Tout dépend. Par exemple, « Les choses qu’on ne peut dire à personne » de Laurent Chalumeau – un texte envoyé il y a longtemps, et bien, j’ai dû en faire deux ou trois versions différentes. Car quand un texte à une musicalité comme celui-là qui me parle, je me mets tout de suite au piano et je fais un canevas. J’enregistre une maquette pourrie… Et puis parfois, deux ou trois jours après, sans avoir écouté ce que j’ai enregistré, je fais une nouvelle version… Jusqu’à me dire : « c’est la bonne version ! ». J’ai des versions qui n’ont rien à voir entre elles : d’autres mélodies, d’autres accords, etc.
« Je vais demander à Chalumeau s’il est inspiré ! »
Quelles sont ces choses que l’on ne peut dire à personne ? Pour vous c’est le diabète ?
Non. Ce qui m’a touché dans le texte de Laurent Chalumeau, c’est son universalité. Ce que je trouve intéressant avec la musique, c’est qu’elle permet de dire différemment des choses que l’on n’arrive pas à exprimer. Rien à voir avec des sentiments honteux. Personnellement, si quelque chose m’énerve, je n’ai pas nécessairement envie d’en faire une chanson car je trouve que cela va mal vieillir. J’ai tendance à être un peu ronchon, je ferais des disques qui seraient vraiment pénibles. Par exemple je dirais : « Y’en a marre des urinoirs connectés qui nous éclaboussent de pisse ! ». Je ne sais pas si ça ferait une super chanson… (Rires). Je vais demander à Chalumeau s’il est inspiré ! (Rires).
Bref, les choses que l’on ne peut dire à personne ne sont pas forcément des choses honteuses. C’est aussi pour cela que je n’écris pas beaucoup de paroles. Prenons le morceau « Sons et Lumière », j’ai essayé de dire ce que je pensais : comment la société d’aujourd’hui vit dans le culte du rock, en comparant ça aux batailles napoléoniennes. Je voulais pouvoir le dire sans être méchant, sans être donneur de leçon ou imprécateur. C’est ça qui est difficile c’est de parler de la société sans être cruel.
Travailler avec un écrivain comme Michel Houellebecq où là c’est la confrontation avec des mots, c’est difficile ?
Cet écrivain a des illuminations. Je me souviens d’un de ses textes sur « Plein été » dans son album. Il y a une phrase que je trouvais incroyable : « Un algérien balaye la terrasse du Dallas ». Pour moi, c’est digne de Ferré. En une phrase, Ferré avait le don de tout dire d’un coup.
Son autre album a été fait avec Jean-Louis Aubert, un autre fils de préfet. Etrange ?
Oui, Jean-Louis Aubert est un fils de préfet, comme moi ! Son père a fait le même parcours que le mien. Le sien est mort il y a quelques années seulement. Le mien, je l’ai perdu très jeune. Et je suis moins fils de « préfecture » que lui car lui, l’est resté longtemps. Je suis très fier de mon père. C’était un mec formidable. Je regrette de ne pas l’avoir connu plus longtemps.
Avez-vous eu envi de retravailler avec Michel Houellebecq ?
Non mais ça a été génial. Ça a pris du temps à l’époque. On s’est connu vers 1995 alors que l’album est sorti en 2000. Ça a mis beaucoup de temps. C’était un peu la période de la sanction à ce moment là. À certains moments, ça a été un peu cruel pour moi. C’est quelqu’un de très talentueux mais parfois, il faut savoir se mettre aux abris. C’est un talent dévorant. C’était des moments difficiles. Mais je n’ai aucun regret, je suis très heureux et fier de ce qu’on a pu le faire.
Vous avez habité Vannes. Que gardez vous de la scène rock en Bretagne. Un groupe comme Marquis de Sade était important pour vous ?
Je n’habitais pas en Bretagne à l’époque de Marquis de Sade. Je me souviens, j’ai passé mon bac à Dijon. La première fois que j’ai vu l’album de Marquis de Sade, c’était chez des amis. Il venait de sortir. Je n’avais pas le disque, mais j’ai beaucoup aimé et particulièrement ce qui a eu après : Octobre, un peu plus funk. « Paolino Parc » d’Octobre, c’était un album que j’avais en cassette préenregistrée. Je connais par cœur ! Je pourrais jouer la ligne de basse de « Nos amis d’Europe ». Je trouve que c’est un album qui a très bien vieilli. J’ai beaucoup aimé cette scène là. Par la suite, j’ai travaillé avec Arnold Tutboust. Je me souviens, la première fois que j’ai vu Daho à la télé – sûrement chez Drucker – chanter « Tombé pour la France », j’avais l’impression d’être comme un partisan de Jacques Cheminade, qui a son champion qui est arrivé au journal de 20H. On se dit : « Putain, ça-y-est ! ». Il y avait quelque chose de générationnel. Tout d’un coup, on s’identifie à ce mec là. Je pense que c’était pareil pour les Rita Mitsouko. C’était encourageant pour tout le monde de les voir passer de quelque chose de très confidentiel à, au contraire, quelque chose de très vaste.
Propos recueillis par Hervé Devallan
Dernier album : « Les choses qu’on ne peut dire à personne » (Tricatel)